Frottis cervical : à quelle fréquence se faire dépister ?
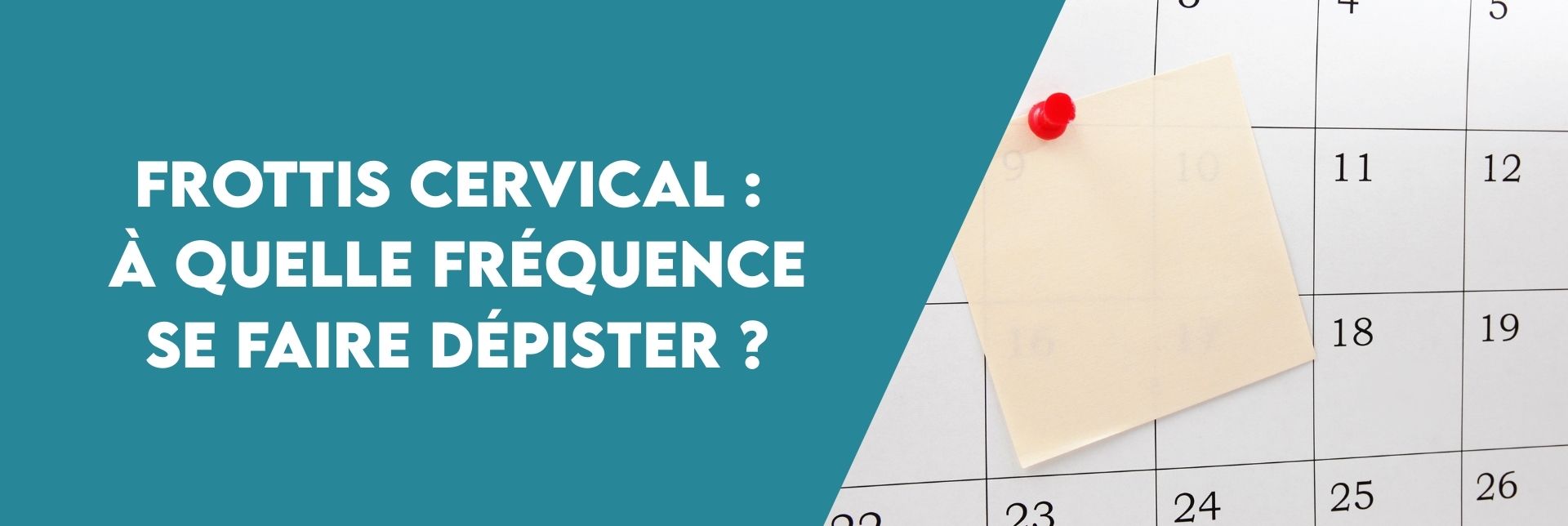
Le frottis cervical de dépistage est l’un des piliers du suivi gynécologique de prévention chez les femmes. Il joue un rôle majeur dans le dépistage du col de l’utérus. Grâce à cet acte préventif, les patientes éligibles au dépistage peuvent bénéficier d’un diagnostic à un stade précoce, augmentant significativement leurs chances de guérison. Pourtant, de nombreuses femmes s’interrogent : frottis cervical tous les combien ? À quelle fréquence doit-on le réaliser ? Quelles sont les recommandations officielles ? Dans cet article, nous répondons à ces questions en explorant les différents aspects du frottis et du test HPV, leurs différences, les délais de résultat du test, ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie.
I. Comprendre le frottis et son rôle dans le dépistage du cancer du col de l’utérus
A/ Le frottis gynécologique : définition, déroulement et objectifs
Le frottis est un examen cytologique réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus. Il consiste à effectuer un prélèvement de cellules au niveau du col de l’utérus, à l’aide d’une petite brosse introduite après la pose d’un spéculum dans le vagin. Cet acte rapide, indolore pour la majorité des femmes, peut être effectué par un gynécologue, une sage-femme, ou lors d’une consultation de contraception.
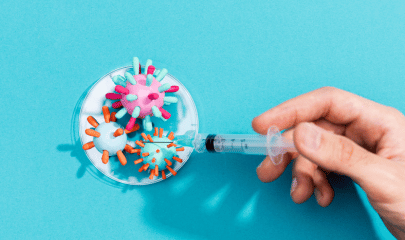
Il est important de noter que certaines situations peuvent influencer la qualité du frottis : un frottis avec règles est généralement déconseillé, tout comme un frottis si la patiente n’a jamais eu de rapport sexuel, bien que ce dernier soit possible en cas de symptômes. Dans de rares cas, lors de la réalisation du frottis, une douleur ou des saignements vaginaux anormaux peuvent survenir après le prélèvement.
Cet acte préventif permet de repérer d’éventuelles anomalies des cellules du col, liées notamment à une infection au papillomavirus humain, qui peut évoluer vers des lésions précancéreuses ou cancéreuses.
B/ Différence entre frottis et test HPV
Le test HPV vise à rechercher la présence du virus du papillome humain à haut risque (virus hpv-hr), responsable du cancer du col. Contrairement au frottis, qui analyse l’aspect des cellules (cytologie), le test HPV repose sur la détection de l’ADN viral, répondant aux recommandations de dépistage définis par les autorités sanitaires.
Ainsi, le frottis permet de détecter des modifications cellulaires, tandis que le test HPV vise la présence de papillomavirus avant même que des anomalies ne soient visibles. En cas de résultat normal au test HPV, un espacement des contrôles est recommandé.
Les deux examens sont complémentaires et s’inscrivent dans le cadre de ce programme de dépistage du cancer du col de l’utérus, piloté par les centres régionaux de coordination des cancers (CRCDC). Ils peuvent être prescrits par divers professionnels de santé et réalisés dans un laboratoire de biologie médicale.
II. À quelle fréquence faire un frottis ? Recommandations et tranches d’âge
A/ Fréquence des frottis selon l’âge et le risque
Selon les recommandations de la HAS, le dépistage du cancer du col de l’utérus débute à l’âge de 25 ans. Entre 25 et 30 ans, il repose sur la réalisation de deux frottis à un an d’intervalle, suivis d’un frottis tous les trois ans en cas de résultats normaux. À partir de 30 ans, le test HPV est préféré : si le résultat du test est négatif, le dépistage est recommandé tous les cinq ans.

Pour les femmes âgées de 50 ans et plus, cette fréquence reste valable jusqu’à l’âge de 65 ans, âge auquel le dépistage peut être arrêté si les derniers tests sont normaux. En revanche, chez les femmes à risque (antécédents de lésions précancéreuses, infection à papillomavirus humain persistante, immunodépression), un suivi gynécologique de prévention plus rapproché est préconisé.
Les patientes consultant pour un frottis cervical doivent aussi tenir compte d’éventuels symptômes : des saignements vaginaux anormaux ou des douleurs pelviennes doivent motiver une consultation, quel que soit le calendrier habituel.
B/ Recommandations du frottis et rôle des professionnels de santé
Les recommandations du frottis sont claires, mais leur mise en œuvre repose en grande partie sur les professionnels de santé. Un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme peuvent assurer le prélèvement cervico-utérin lors d’un rendez-vous annuel ou dans le cadre d’une consultation de contraception.

Les documents de l’INCa et les courriers d’invitation envoyés par les centres régionaux de coordination des cancers permettent aux femmes de suivre leur dépistage. Le document reçu est accompagné d’une feuille de demande, à présenter au laboratoire de biologie médicale.
Un frottis de type ASC-US, c’est-à-dire un frottis révélant des cellules de signification indéterminée, conduit à un test HPV ou à un nouveau frottis plus rapproché. Dans tous les cas, la présence de papillomavirus doit être suivie avec attention pour prévenir l’évolution vers des lésions de haut grade.
III. Résultats, prise en charge et remboursement du frottis
A/ Résultats d’un frottis : délais, interprétations et anomalies
Le délai d’obtention des résultats du frottis dépend du laboratoire de biologie médicale. Il varie entre quelques jours et une semaine. Certaines patientes reçoivent leur résultat de frottis par courrier, accompagné d’un compte-rendu.
Les résultats peuvent être normaux ou révéler des anomalies. Un frottis négatif signifie qu’aucune anomalie n’a été détectée. En revanche, un frottis anormal peut indiquer une lésion bas grade, une infection par un virus, ou plus rarement une lésion de haut grade de type ASC-H. Le résultat de ce test détermine la suite du suivi gynécologique de prévention.
En cas de doute, un nouveau prélèvement de cellules ou une colposcopie peuvent être prescrits. L’objectif est toujours d’intervenir avant l’apparition de lésions précancéreuses.

B/ Prise en charge, remboursement et suivi après un frottis
Le frottis, qu’il soit de dépistage ou de contrôle, est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre de ce programme de dépistage du cancer. Cela inclut le prélèvement de cellules, l’analyse en laboratoire de biologie médicale, ainsi que le résultat du test.
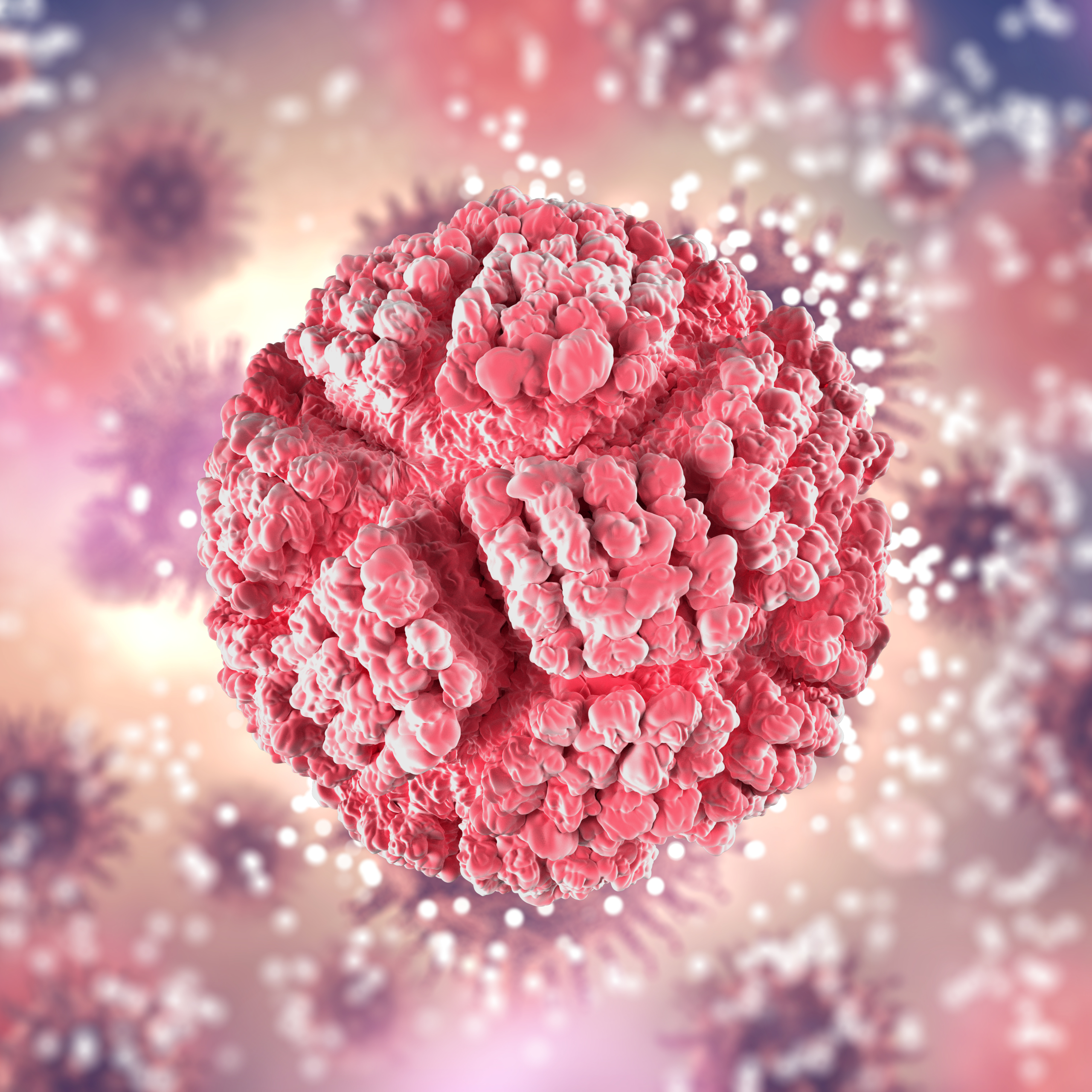
Les patientes peuvent consulter un praticien de leur choix : gynécologue à l’hôpital, gynécologue en téléconsultation, médecin généraliste, ou sage-femme. Le dépistage est organisé sur l’ensemble du territoire pour garantir un accès égal aux soins.
En cas de présence de papillomavirus, une surveillance régulière est essentielle pour éviter toute progression vers un cancer. Une détection à un stade précoce garantit de meilleures chances de guérison.



