Cytomegalovirus (CMV) : tout ce qu’il faut savoir !
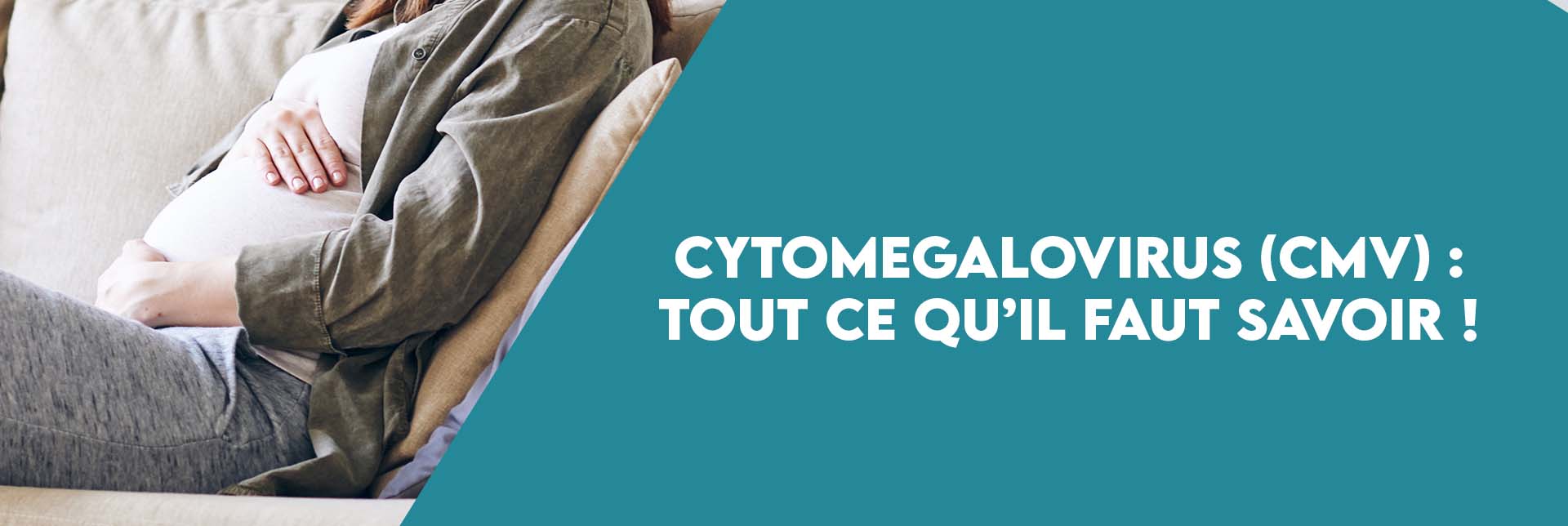
Le cytomégalovirus (CMV) est un virus appartenant à la famille des herpèsvirus. Ce virus de la famille des herpèsvirus est très répandu dans le monde, notamment dans les pays industrialisés. Il peut infecter toute personne, quel que soit son âge, et reste souvent silencieux chez les personnes en bonne santé. Cependant, l'infection à CMV peut entraîner des conséquences graves chez les patients immunodéprimés, les femmes enceintes et les nouveau-nés. La transmission du CMV se fait par contact direct avec les fluides corporels, notamment les sécrétions génitales, le sang, la salive, l'urine, et le lait maternel.
Malgré une infection à cytomégalovirus souvent asymptomatique chez les enfants, la présence de CMV dans l'organisme ou un contact avec le CMV peuvent être détectés par différents tests, comme la sérologie, le test d'avidité ou la PCR. Des mesures d'hygiène simples permettent de réduire les risques de contamination par le CMV, en particulier chez les femmes enceintes où le virus peut être transmis de la mère à l'enfant. Cet article vous présente en détail le CMV, ses symptômes, ses modes de transmission, les diagnostics possibles, ainsi que les traitements antiviraux disponibles.
I/ Le cytomégalovirus : définition, transmission et incubation
A/ CMV définition et transmission
Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus appartenant à la famille des herpèsvirus. Comme ses cousins les virus Epstein-Barr, le virus de la varicelle ou l’herpès simplex, il reste latent dans l’organisme après la première infection. Cette infection à cytomégalovirus est très courante, surtout chez les jeunes enfants, souvent porteurs du virus sans présenter de symptômes. La contamination par le CMV peut survenir à tout âge, mais la transmission est fréquente chez les enfants en bas âge. Le CMV se transmet par voie orale, lors de rapports sexuels, ou par contact avec les urines, la salive ou d’autres fluides corporels. Cette facilité de transmission explique sa prévalence élevée dans la population.

Chez les femmes enceintes, la transmission au fœtus est une source d’inquiétude, car elle peut engendrer des séquelles graves chez le futur bébé. L’infection congénitale est possible notamment lors du premier trimestre de grossesse. Dans les cas graves, le CMV peut provoquer, la surdité, une rétinite à CMV, une atteinte hépatique ou des maladies cardiaques et digestives. Les jeunes enfants sont souvent porteurs du virus et le transmettent par leurs sécrétions. L’immunité cellulaire joue un rôle déterminant dans la réactivation du virus chez les patients immunodéprimés.

B/ Durée d'incubation et contagiosité du CMV
Le CMV présente une période d'incubation variable, généralement comprise entre 3 et 12 semaines selon le mode de transmission. L'infection à CMV peut être asymptomatique ce qui peut compliquer son diagnostic. En général, les symptômes apparaissent après cette phase silencieuse, surtout en cas d'immunité affaiblie. Chez les patients immunodéprimés, la réactivation du virus peut entraîner des maladies graves touchant la moelle épinière, les poumons, le foie ou le tube digestif.
La contagiosité du CMV est élevée, surtout dans les collectivités d'enfants. La présence de CMV dans les urines ou les sécrétions génitales constitue une source de propagation importante. Il est recommandé de respecter les mesures d'hygiène comme le lavage des mains, la stérilisation des objets partagés, ou encore l'usage d'eau bouillante pour les biberons. Dans le cadre d'une grossesse, des échographies mensuelles permettent de suivre le développement du fœtus en cas d'infection. Il est également possible de recourir à une amniocentèse précoce ou un test d'avidité pour évaluer la récente exposition au virus.
II/ Symptômes, diagnostics et traitements du CMV
A/ Symptômes du CMV chez l'adulte, la femme enceinte et l'enfant
Les symptômes du CMV varient considérablement selon l’âge et l’état du système immunitaire.
Chez les adultes en bonne santé, le CMV peut passer inaperçu ou provoquer des symptômes similaires à la mononucléose : fièvre, fatigue, douleurs musculaires, et ganglions enflés. La maladie peut s’atténuer spontanément en quelques semaines.
Chez la femme enceinte, l’infection à CMV peut être asymptomatique, mais les risques pour le fœtus sont importants. Le CMV pendant la grossesse peut entraîner une atteinte neurologique, des troubles auditifs (surdité neurosensorielle), un retard de croissance voire la mort foetale in utero. Les conséquences du CMV peuvent être irréversibles, avec des séquelles graves à la naissance. Chez le nourrisson, les symptômes du CMV incluent ictère, convulsions, microcéphalie, ou retard mental.
Chez l’enfant, les signes cliniques du CMV peuvent être discrets : fièvre modérée, irritabilité, troubles digestifs. Toutefois, la majorité des enfants reste asymptomatique. Chez l’adulte, les séquelles sont rares mais possibles, notamment chez les personnes ayant une immunodépression.


B/ Tests, diagnostics et traitements du cytomégalovirus
Le diagnostic d’une infection à CMV repose sur plusieurs outils. Une prise de sang permet de mesurer les anticorps spécifiques : IgM et IgG CMV. Un CMV IgG positif et IgM négatif signifie une infection ancienne sans toutefois être protégé d’une infection secondaire. Tandis que des IgM positives peuvent indiquer une infection récente et nécessite un contrôle à distance. Le test d’avidité peut aider à dater l’infection. Dans certains cas le diagnostic prénatal d’infection congénitale à CMV est complété par une amniocentèse en vue d’une PCR CMV sur le liquide amniotique.
La sérologie CMV est recommandée dans le cadre du dépistage systématique chez les femmes enceintes ou avant une greffe. Les médecins spécialisés peuvent conseiller ce test en cas de doute cliniques.
Le traitement cytomégalovirus dépend du contexte. Chez les patients immunodéprimés, des médicaments antiviraux comme le ganciclovir ou le valganciclovir sont administrés. Le traitement pour la femme enceinte n’est pas toujours indiqué, sauf en cas de sévère atteinte fœtale. En cas de sérocconversion CMV au premier trimestre de grossesse le valaciclovir peut être administré par des équipes spécialisées et, une surveillance accrue s’impose.
Il n’existe pas encore de tests pour détecter une réinfection ou une réactivation.
Les médecins du travail ou les professionnels de la santé en contact avec de jeunes enfants doivent être informés du risque.
III/ Immunité, prévention et perspectives futures

A/ Immunité et réactivation du virus
Après l'infection, le virus reste dans l'organisme à l'état dormant. L'immunité de la personne permet généralement de contenir la réplication virale. L'immunité cellulaire joue un rôle essentiel pour éviter une réactivation du virus. Toutefois, chez les patients immunodéprimés ou en cas de stress intense, le virus peut se réactiver, provoquant une nouvelle infection à CMV.
B/ Prévention et avenir de la lutte contre le CMV
La prévention repose essentiellement sur les mesures d'hygiène : lavage des mains, non-partage des ustensiles, stérilisation, éviter les contacts avec la salive et les lamres des enfants et des bébés, éliminer rapidement les couches humides des bébés et enfants. Il convient d'éviter d'embrasser un bébé ou un enfant sur la bouche ou sur les joues lorsqu'il pleure, ces gestes pouvant être remplacés par un câlin, le prendre dans ses bras ou l'embrasser sur le front ou sur les cheveux. Ces précautions concernent aussi bien le père que la mère.
Des vaccins sont à l'étude, car la vaccination serait un moyen efficace de protéger les populations vulnérables. Comprendre les propriétés biologiques fondamentales du virus permettra à terme de développer des stratégies préventives plus ciblées.


Conclusion
Le cytomégalovirus est une maladie virale fréquente mais méconnue. Si elle reste souvent asymptomatique, ses conséquences peuvent être graves en cas de transmission au fœtus, chez les patients immunodéprimés ou les nourrissons. La présence de CMV dans l'urine, le sang ou les sécrétions doit alerter, en particulier chez la femme enceinte. La détection précoce, via le diagnostic de l'infection ou le dépistage systématique, et le recours aux traitements antiviraux adaptés permettent de limiter les conséquences. Une meilleure sensibilisation, combinée à des progrès dans les tests et vaccins, peut améliorer la prise en charge à l'heure actuelle.



